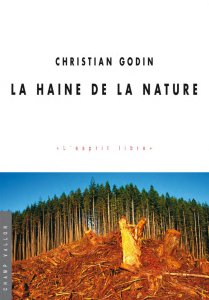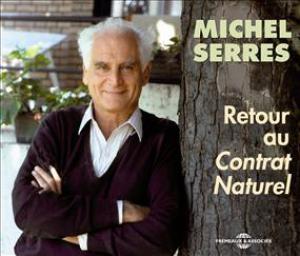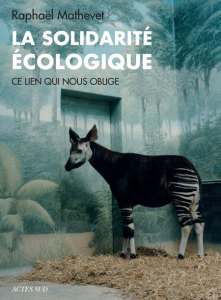Pour vous la nature c'est ....
Le wild !! |
|---|
Un patrimoine universel ! |
Un réservoir d'émotions fortes ! |
Des bébêtes qui font peur ! |
La forêt près de chez moi ! |
Une ressource naturelle ! |
Des services rendus ! |
La biodiversité ! |
Nous avons vu comment la conservation de la biodiversité est devenue la principale motivation pour la création d'espaces naturels protégées. En tant que mode d'intervention sur la nature, les politiques de mises en place d'espaces naturels héritent des conceptions portées sur la nature. Quelles sont elles?
Remarque :
Il y a plusieurs façons de penser notre rapport à l'environnement et à la nature
« Chaque individu entretient une vision individuelle de la nature...l'écologie est un terrain de jeu où s'affrontent nos systèmes de valeurs »
Écologie et société[1]
Complément : Extrait d'une conférence d'Yves Vérilhac (ancien directeur de l'Aten), vidéo réalisée par SupAgro Florac
Morceaux choisis
Les différentes manières de penser la nature :
Une vision naturaliste bio-centrée : ce sont des personnes qui sont focalisées sur la nature avec un grand N (activités humaines destructrices)
Une éthique anthropocentrée : l'homme est au cœur de son environnement, la faune et la flore sont présentes pour le servir. Par exemple :
« Pourquoi il faut protéger l'eau ? Parce que je la bois et c'est pour ma santé »
Pour une utilisation hors-ligne, retrouvez l'interview d'Yves Vérilhac |
|---|
Des hommes omniprésents qui craignent la naturalité ?
Les milieux naturels en Europe sont le résultat d'une évolution de la faune et de la flore, impactée par des activités humaines, positivement ou négativement. Pour les cultures de l'antiquité puis judéo-chrétienne, l'usage des milieux naturels est anthropisé par des siècles agricoles et sylvicoles. La nature est régie depuis des siècles par une économie du « bon usage » et de l'aménagement, héritage conjugué de Colbert et Descartes. En France, il n'est pas concevable d'envisager une protection de la nature sans intervention sur les milieux naturels. Même si on choisit un haut niveau de protection qui réglemente les activités humaines, le concept de gestion est omniprésent avec des argumentations scientifiques, économiques et culturelles. Les milieux naturels sont gérés : entretien, restauration voire recréation à travers des opérations de génie écologique.
Aurions-nous peur de la nature ? François Terrasson et Christian Godin se sont particulièrement penchés sur la question
Christian Godin Philosophe français, Maître de conférence à l'université de Clermont-Ferrand. Dans La haine de la nature[2][2] , il propose une "psychanalyse de l'homme actuel...devenu l'ennemi impitoyable de la nature". |
L'anthropocentrisme : l'homme au centre de l'environnement
La pensée occidentale contemporaine est dominée par une éthique anthropocentrique. Les religions se sont interrogées sur la place de l'homme dans la nature et l'attitude à adopter à son égard. Si l'on prend l'exemple du christianisme, est-ce que la bible invite les humains à exploiter sans limite les ressources de la terre ?
La nature et les êtres vivants possèdent une valeur dite instrumentale, c'est à dire une valeur qui est fonction de leur utilité pour l'homme. La nature est perçue comme un « environnement »
. L'homme y trouve des ressources qui répondent à son besoin. La nature est un milieu de vie, une source de connaissances, un ensemble de ressources exploitables mais aussi l'objet d'expérience esthétique. « Il faut donc protéger l'air qu'on respire, l'eau parce qu'on la boit, les espèces végétales ou animales parce qu'elles nous rendent des services (nourriture, médecine...) »
. Yves Vérilhac
Lors de la création des premiers espaces naturels protégés, aux États-Unis, Gifford Pinchot responsable du Service des forêts est le chef de file des conservationistes. Il prône une exploitation raisonnée des ressources de la nature, permettant son renouvellement. Il s'agit de faire un bon usage de la nature, ressource qu'il convient de protéger afin de ne pas compromettre le mode de vie des hommes et des générations futures. Gifford Pinchot est peut être bien l'arrière grand-père du développement durable.
Attention :
Attention, en français, le terme conservation signifie une approche patrimoniale qui est de garder en l'état les monuments naturels que peuvent être certains paysages ou milieux naturels.
Le biocentrisme : la nature a une valeur intrasèque et non-instrumentale
L'approche biocentrique consiste à inclure l'ensemble des êtres vivants dans la sphère des individus méritant une considération morale directe. La nature est à protéger parce qu'elle a une valeur en elle- même, quelque soit son usage par l'homme. Les êtres humains ont le devoir moral de la respecter. Dans le préambule de la Convention sur la diversité biologique, les pays signataires se déclarent conscients de la « valeur intrinsèque »
de la biodiversité. L'éthique biocentrique débouche alors sur des interdits et des restrictions
« La nature est a-morale mais nous avons le devoir de la protéger car nous sommes des êtres moraux »
,
Du bon usage de la nature[3]
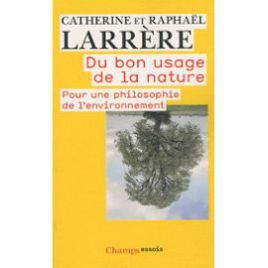 Couverture du livre Du bon usage de la nature par Catherine et Raphaël Larrère ©librairie-des-sources.over-blog.com | Un courant biocentrique : le wilderness Au 19ème, les États-Unis ont développé le concept du wilderness qui va influencer largement la création des Parcs nationaux. Traduit par « naturalité » en français, il renvoie à la définition de la nature au sens littéral : là où l'homme n'intervient pas et qui s'exprime librement et spontanément. Le terme vient d'ailleurs de wildness qui signifie « extravagant, incontrôlable». Né de l'esprit romantique européen, ce courant fut adopté par des écrivains américains qui firent le récit de leur immersion dans des contrées sauvages. Il est tout d'abord une exaltation de la nature sauvage. Puis une protestation de la surexploitation des milieux naturels car pour les premiers colons imprégnés de culture biblique, la nature est perçue comme un milieu hostile qu'il faut conquérir et domestiquer, au même titre que les populations amérindiennes qui y vivent. Cette conception résulte de la colonisation et de ses excès et engage à un devoir moral de réparation de la nature, victime en quelque sorte du péché de destruction par les premiers colons. Aux États-Unis, les partisans de la préservation, avec à leur tête John Muir, sont opposés à la commercialisation de la nature et à son exploitation. Pour la défendre contre les intrusions humaines, une mise sous cloche est de rigueur. En France, le "wilderness" a inspiré les courants artistiques ou littéraires mais a eu peu d'échos dans la politique de création d'espaces naturels à protéger. |
Philosophe qui réfléchit aux rapports que les hommes entretiennent avec la nature. La thèse de l'ouvrage est l'impossibilité de penser les sciences de la nature d'un côté et celles de l'homme de l'autre. Les auteurs avancent la nécessité de dépasser l'opposition traditionnelle du naturalisme et de l'humanisme, pour articuler l'un avec l'autre.
Attention :
Attention : en Français, le terme de préservation a une acception différente et admet la place de l'homme pour gérer les milieux naturels.
La valeur patrimoniale de la nature
Il s'agit de la valeur culturelle, identitaire ou historique qui fait de la nature un patrimoine à conserver, pour le présent et les générations futures.
Le mythe du sanctuaire de nature et l'ethnocentrisme occidental
Les héritiers de John Muir défendent le principe d'un espace sanctuaire inaccessible aux humains. Quelle place accorder aux peuples autochtones ? L'histoire de la création d'espaces protégées est ponctuée d'expulsions et de déplacements de populations, suscitant de véritables guérillas. A la fin du 19ème siècle, le parc de Yellowstone est né d'une guerre indienne contre le territoire des Shoshones, mis sous tutelle de l'armée.
Les pays non occidentaux ont critiqué cette conception d'une nature sanctuaire soit inhabitée, soit vidée de ses habitants. Surtout lorsque la création d'espaces protégés est justifiée par un sentiment de rédemption après l'exploitation massive de ressources naturelles gratuites, en libre accès dont la société coloniale a bénéficié. Ce mythe de la nature décliné dans la mentalité coloniale a nié les populations locales, sur tout les continents.
A partir des années 1970, les mentalités ont évolué vers une approche plus participative de la conservation écologique avec les populations locales. Elles sont de plus en plus associées à la gouvernance de leur territoire.
L'écocentrisme
L'éthique écocentrique est une éthique de devoirs et de bonnes pratiques dans nos comportements vis à vis de la nature.
Michel Serres La démarche de Michel Serres s'inscrit dans une philosophie du droit. Après des siècles de domestication, d'instrumentalisation et de domination de la nature, il propose à l'humanité de s'engager dans "un contrat naturel" avec la nature. L'homme s'engage à respecter le monde qu'il a reçu en partage par une réconciliation et une reconnaissance des devoirs de l'humanité envers la nature. |
Quel lien pragmatique entre écocentrisme et anthropocentrisme ? : la solidarité écologique
Le concept de solidarité écologique a été développé par le chercheur Raphael Mathevet, sur lequel repose la création d'une nouvelle génération de Parc nationaux en France à partir de 2006. Les espaces naturels protégés ne contiennent pas, le plus souvent, la surface nécessaire à la dynamique et au bon fonctionnement des systèmes écologiques : les enjeux de conservation dépassent alors largement les périmètres des seuls espaces protégés.
« La dimension spatiale des processus écologiques a pris une place de plus en plus importante dans la compréhension des mécanismes qui sous tendent la dynamique de la biodiversité.Il est nécessaire de pouvoir comprendre, expliquer et gérer les liens qui existent entre l'organisation spatiale des habitats naturels à l'échelle du paysage (les patterns) et les mécanismes écologiques (les processus) qui sous tendent la dynamique de la biodiversité et le fonctionnement des systèmes écologiques. Il est important de reconnaître la réciprocité de ses interactions. Autant la nature sort de sa réserve et dépend pour son bon fonctionnement des espaces environnants, autant les activités humaines en dehors de l'espace protégé peuvent influencer la biodiversité au sein de cet espace. C'est ici que la solidarité écologique prend tout son sens. »
Raphaël Mathevet Écologue et géographe, il développe le concept de solidarité écologique[4], fondement de la réforme des parcs nationaux de 2006. |
D'une approche ségrégative à une approche intégrative de la nature
Le cliché d'une mise sous cloche de la nature est ébranlé lorsqu'on analyse la mise en œuvre des pratiques de conservation. De plus en plus, ces pratiques intègrent les différentes composantes multifonctionnelles d'un territoire. D'où l'évolution d'une approche ségrégative vers une approche intégrative de la nature, comme l'illustre l'étude « Des clichés protectionnistes aux approches intégratives : l'exemple des réserves naturelles de France » , de Clara Therville.
APPROCHES SÉGRÉGATIVES | APPROCHES INTÉGRATIVES | |
|---|---|---|
Généralités | ||
Dénomination dans la littérature | Paradigme radical, modèle classique/traditionnel | Paradigme intégrateur, conservation intégrée, participative, nouvelle |
Images | Mise sous cloche | Sortir de sa réserve, outil de développement durable |
Période | Avant 1980 | A partir des années 1980 |
Outils | Réserves intégrales, parcs nationaux et réserves naturelles | Aires protégées intégrées (ICDP, réserves de biosphère), gestion communautaire, patrimoniale, adaptative, PNR[7][5], réseaux (TVB[8][6], N2000), intersectorialité |
Objectifs | Objectif prioritaire : conservation | Objectifs multiples : sociaux, environnementaux, économiques |
Modèles | Protection, préservation | Conservation, patrimonialisation |
Objets | Nature sauvage, rare, spectaculaire, wilderness | Biodiversité, patrimoine naturel, patrimoine socioculturel |
Points de vue dominants | Politique et enjeux définis par l’État | Politique et enjeux locaux, décentralisation. Politique et enjeux nationaux et internationaux |
Caractéristiques | ||
Éthique | Plutôt biocentrée | Plutôt écocentrée et anthropocentrée |
Rapport Homme/Nature | L'homme en dehors de la nature, une menace | L'homme comme une partie de la nature, un auxiliaire |
Valeurs | Intrinsèque, esthétique | Patrimoniale, économique, culturelle |
Philosophe de la conservation | Compositionnaliste | Fonctionnaliste |
Point de vue des écologues | Climax, stabilité | Perturbation, instabilité, évolution, complexité |
Approche disciplinaire | Approche naturaliste | Sciences de la conservation et interdisciplinarité |
Concepts et méthodes associés | Nature, wilderness | Développement durable, sociosystème, résilience, fonctionnalité, gestion différenciée, services écosystémiques, solidarité écologique... |
Gestion | ||
Accès et usages | Réserve intégrale. Accès : scientifiques, visiteurs | Intégration des usagers locaux. Ouverture large et moins sélective |
Outils et méthodes | Approche réglementaire stricte, maîtrise foncière | Approche réglementaire souple, négociée, gestion contractuelle, éducation à l'environnement |
Techniques de gestion | Gestion rigide à court terme. Gestion technocratique | Gestion adaptative à long terme. Gestion sociopolitique |
Moyens financiers | Contribuable, État | État, collectivités locales, mécénat, autofinancement... |
Compétences de gestion et savoirs | Experts. Gestion scientifique, naturaliste, technique | Compétences multiples : naturaliste, médiateur, éducateur, scientifique. Savoirs locaux et populaires |
Répertoire de justification | La nature remarquable, wilderness | Services rendus, bien-être humain, développement, valeur économique |
Gouvernance | Gouvernement central | Nombreux partenaires |
Acteurs locaux | Aires protégées créées contre les acteurs locaux | Aires protégées créées avec, pour et parfois par les acteurs locaux |
Liens aux territoires environnants | Développement indépendant. Gestion séparée du territoire, ségrégation spatiale | Développement dans des projets politiques larges. Développement en réseau. Considération des interdépendances fonctionnelles |
D'après Phillips, A. 2003. Turning ideas on their head: the new paradigm for protected areas. Environmental History 9(1):173-198
Adapté au contexte français par Clara Therville dans le cadre de sa thèse : Des clichés protectionnistes aux approches intégratives : l'exemple des réserves naturelles de France