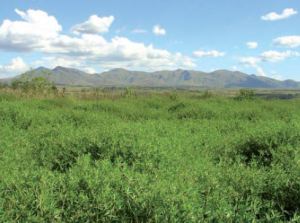Définition :
Les principes d'identification des systèmes possibles et ceux du choix des systèmes à proposer aux paysans dans chacune des unités agronomiques sont appliqués dans chaque grande région agricole pour proposer des systèmes les plus proches possibles des systèmes paysans. Pour cela, il est nécessaire de considérer les caractéristiques principales de chaque région et d'en tirer les éléments déterminants
Au Lac Alaotra et dans le Moyen-ouest, comme très souvent à Madagascar, le premier facteur à prendre en compte est le besoin (ou le souhait) du paysan de cultiver du riz sur la parcelle en question.
De la même manière, ses capacités d'investissement en intrants et travail déterminent très largement les possibilités de systèmes
Enfin, ses besoins en fourrages pour le bétail ainsi que les risques de divagation d'animaux sont essentiels aux choix des plantes associées aux cultures principales.
Ces trois facteurs sont ainsi utilisés en priorité et constituent les trois premières clefs d'entrées dans les tableaux de synthèse permettant de raisonner ces choix de systèmes dans ces régions.
D'autres facteurs permettent ensuite d'affiner le choix des systèmes :
|
Dans tous les cas, les cultures (céréales, légumineuses, tubercules) peuvent être installées sur labour en première année et doivent être associées autant que possible à des plantes, qui peuvent être :
des légumineuses alimentaires comme les vignas (Vigna umbellata et niébé = Vigna unguiculata), qui permettent d'obtenir un revenu supplémentaire (à condition d'effectuer des traitements insecticides indispensables pour la production de grains),
des plantes fourragères pour nourrir les animaux ou au contraire des plantes qui ne sont pas appétées par les animaux pour se prévenir du risque de divagation, et/ou
des plantes dont la fonction première est d'enrichir les sols et d'en améliorer la structure et/ou de contrôler l'enherbement.
S'il existe de la biomasse disponible dans le milieu environnant, toutes les cultures profiteront d'un paillage en première année (protection contre l'érosion, moins de sensibilité au stress hydrique, moins d'enherbement). Si la biomasse est limitée, il faut donner la priorité pour le
paillage aux parcelles de Vigna umbellata (qui ne doit pas être cultivé sans paillage), au riz (sensible au stress hydrique, exigeant des sarclages longs) et au pois de terre (qui voit son rendement augmenter très fortement).
Attention :
Il est important de produire et restituer au sol une forte biomasse aérienne et racinaire au moins une année sur deux, pour alimenter le semis direct sur couverture végétale permanente (apport de matière organique, amélioration de la porosité du sol et maintien d'une couverture en permanence).
Plus le nombre et la diversité des espèces produites dans les systèmes sont élevés, plus la production de biomasse et les services écosystémiques rendus sont importants, mais en revanche, plus la gestion en est compliquée. Il s'agit donc de trouver des compromis entre facilité de gestion et performance des systèmes, et entre production de grains/tubercules/fourrages et production de biomasse pour le bon fonctionnement des SCV. Dans un premier temps, pour l'apprentissage des SCV, la priorité est donnée à des systèmes simples à gérer, avec un nombre limité de plantes multifonctionnelles. Les systèmes présentés ici se limitent donc à ces systèmes qui conjuguent simplicité et performances.